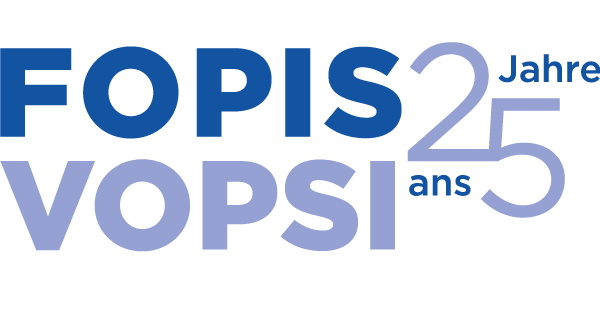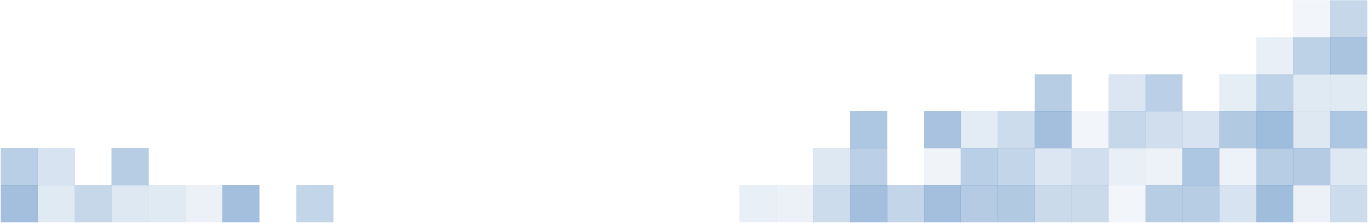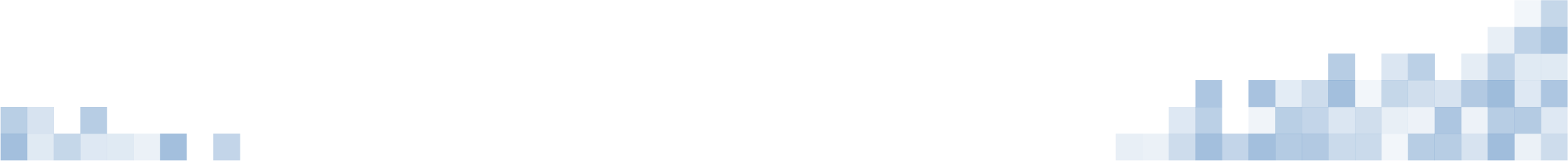Les questions du mois
Comment est fixé le salaire à l’engagement?
La fixation du salaire dépend en premier lieu de la fonction pour le lequel le collaborateur est engagé. Par exemple, un logopédiste recevra la classe 20et un maître socioprofessionnel au bénéfice d’un CFC et d’une formation supérieure (ES) la classe 18.
Chaque classe comportant un minimum et un maximum, il conviendra ensuite de déterminer le nombre de paliers entre le minimum et le maximum en tenant compte de l’expérience professionnelle et personnelle de l’intéressé.
Seront pris en considérations toutes les années de travail accomplies dans la profession ou la fonction pour laquelle le collaborateur est engagé. Chaque année d’expérience professionnelle correspondra à un palier de la classe.
Lorsque l’expérience professionnelle a été acquise dans d’autres domaines que l’activité prévue, avec un taux d’activité d’au moins 50%, cela donne droit d’un à trois paliers suivant le type d’activité.
Quant aux personnes qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper de leurs enfants (jusqu’aux 16 ans révolus du plus jeune), elles peuvent obtenir un palier pour trois années complètes d’activité, mais au maximum trois paliers. Cette règle s’applique aussi à ceux qui ont exercé une activité socio-éducative, socioculturelle ou humanitaire dans le cadre d’institutions publiques ou reconnues d’intérêt public.
Enfin lorsque la personne engagée n’a pas la formation ou l’expérience requise pour exercer sa fonction, le salaire (traitement initial) est fixé dans une classe inférieure à celle de la fonction. Dès que le collaborateur répond aux exigences de la fonction, après une formation en cours d’emploi, son salaire est corrigé pour correspondre aux critères définis ci-dessus (classes de la fonctions).
Voir la réponse
Les congés usuels!
La CCT (art. 20.2) prévoit des congés payés de courte durée en cas d’événements familiaux tels que mariage, naissance, décès, maladie d’un proche ainsi qu’en cas de déménagement, de licenciement militaire, etc.
Pour chacune de ces catégories de congé, la CCT prévoit une durée fixée en jours ou demi-jours par événement ou par an (par exemple, 1 jour en cas de déménagement, jusqu’à 5 jours par an pour s’occuper d’un enfant malade).
L’art. 20.3 consacre le droit à des congés payés de courte durée liés à l’accomplissement d’obligations légales (par exemple, être cité à comparaître en qualité de témoin devant un tribunal) ou à des événements particuliers (par exemple, rendre visite à un proche malade).
Les visites médicales effectuées durant le temps de travail doivent être traitées différemment selon qu’il s’agit d’une urgence ou pas. Dans le premier cas, il s’agit à l’évidence d’un empêchement de travail non fautif en raison d’une cause inhérente à la collaboratrice. De même, les contrôles, cures, examens, traitements préventifs prescrits par un médecin constituent des incapacités de travail pour une cause inhérente à la personne. Dans ces cas, le droit au salaire est garanti pour la durée de ces empêchements.
En dehors d’une situation d’urgence ou d’un traitement prescrit, il n’existe pas un droit à bénéficier d’un congé payé pour une visite médicale. Si la travailleuse ne peut pas faire autrement, c’est l’art. 20.3 CCT mentionné plus haut qui s’applique. Toutefois la compétence d’accorder des congés payés de courtes durées « pour des événements particuliers » appartient à la direction. Cette dernière disposition limite fortement la portée du « droit » accordé au premier alinéa.
La CCT (art. 4.6) prévoit également qu’une fois le contrat dénoncé, l’employeur accorde à la travailleuse le temps nécessaire pour rechercher un autre emploi. Ce congé est accordé quelque soit la manière dont les rapports de travail ont pris fin (résiliation par l’une ou l’autre partie ou arrivée à échéance d’un contrat de durée déterminée). Le temps nécessaire de ce congé dépend des circonstances du marché du travail et de la nature de l’activité recherchée. Le moment et la durée de l’absence doivent faire l’objet d’un accord entre la direction et la collaboratrice. Bien que la loi ne le spécifie pas, il est clair que selon les usages – ainsi que selon l’art 20.3 alinéa a) CCT – le congé pour la recherche d’un emploi doit être rémunéré.
Voir la réponse
A-t-on le droit de s’absenter du travail pour une visite médicale?
La Commission arbitrale a donné un avis d’interprétation le 23 août 2012 concernant le droit ou non de s’absenter de son travail pour se rendre à une visite médicale.
L’art 20 CCT (alinéa 2 à 6) prévoit une liste exhaustive des congés payés de courte durée. Le congé pour visite médicale n’en fait pas partie. Ces dispositions sont complétées par celles de l’art 20.1 CCT lequel prévoit que l’interruption du travail pour des motifs autres que les vacances, la maladie, un accident, une grossesse, une maternité ou un service militaire nécessite l’octroi d’un congé. Quant à l’art 26 CCT, il prévoit la rémunération du travailleur en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
Une visite médicale peut constituer un empêchement non fautif inhérent à la personne du travailleur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une rémunération pour la durée de l’empêchement. Par contre, ce droit n’existe pas lorsque le travailleur aurait la possibilité de fixer une visite médicale en dehors de son horaire de travail. C’est notamment le cas pour la personne occupée à temps partiel ou bénéficiant de l’horaire libre lui permettant de gérer lui-même avec une certaine autonomie son temps de travail. La distinction entre ces deux situations n’est pas toujours aisée. Des directives internes peuvent être édictées par une institution en tenant compte des différents types d’horaires pratiqués et de leurs contraintes (travailleurs soumis à un horaire imposé et travailleurs soumis à un horaire flexible, par exemple).
Les lignes directrices adoptées par le Service du personnel et de l’organisation du canton de Fribourg (SPO), entre autres celles concernant les visites médicales, ne s’appliquent « ni directement, ni pas analogie aux collaborateurs et collaboratrices soumis à la CCT INFRI-FOPIS ».
Voir la réponse
Les jours fériés légaux et conventionnels
Comme le prévoit la Loi sur le travail, le canton de Fribourg a fixé 8 jours fériés assimilés à un dimanche: Nouvel An, Vendredi-Saint, Ascension, Fête-Dieu, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël auxquels s’ajoutent le 1er août.
La CCT prévoit 4 autres jours fériés: le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 26 décembre et 2 demi jours (après- midi du 1er mai et du 24 décembre). Il est également prévu que lorsque Noël et le Nouvel An tombent un mardi ou un samedi, les jours précédents ces deux fêtes sont chômés (art. 19 CCT) et que la veille des jours fériés, le travail se termine à 16h00.
La Constitution fédérale (art. 110) prévoit que le 1er août doit être rémunéré. Pour les autres jours fériés, le droit au salaire découle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 7), entré en vigueur en Suisse le 18 septembre 1992.
Lorsqu’un jour férié tombe pendant les vacances, il ne compte pas comme jour de vacances. Par exemple, si le 1er août est un mercredi, la personne en vacances durant cette semaine-là aura pris quatre jours de vacances (au lieu de cinq). Il lui restera un jour de vacances.
Les jours fériés étant assimilés à des dimanches, ils ne peuvent pas être compensés en cas de maladie par des jours de congés pris à un autre moment.
Lorsque le collaborateur ou la collaboratrices est tenu-e d’accomplir une partie de son horaire de travail durant les jours fériés prévus par la CCT, il ou elle a le droit de prendre un congé de durée équivalente.
Dans ses annexes 6 et 6 bis, la CCT précise que l’horaire annuel moyen est de 1900 heures (établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 42 heures réparties sur 5 jours). Il s’agit d’un volume d’heures annuelles net (après déduction des semaines de vacances et des jours fériés).
Pour le personnel payé à l’heure, le salaire des jours fériés est versé en supplément au salaire-horaire au taux de 4%.
Voir la réponse
Quelle est la protection pour les données personnelles de la travailleuse?
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) limite strictement la collecte et l’utilisation d’informations sur les travailleuses. L’employeur ne peut réunir des informations « que dans la mesure où ces données portent sur l’aptitude de la travailleuse à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail » (CO 328b). Il s’agit des diplômes, des certificats de travail antérieurs, les données relatives à l’âge, le domicile, l’état civil, le numéro AVS, le numéro de compte bancaire ou postal. A cela, peuvent s’ajouter des informations comme les certificats médicaux d’incapacité de travail, les évaluations de prestations, les attestations de formation continue ainsi que tous les échanges de correspondance avec la travailleuse. L’employeur doit traiter les renseignements qu’il possède sur la travailleuse en respectant les principes de la bonne foi (pas d’informations récoltées à l’insu de la travailleuse ou contre sa volonté), de proportionnalité (ne collecter que les informations vraiment indispensables à l’exécution du contrat de travail, ne pas communiquer par voie d’affichage des informations sur une employée à l’ensemble du personnel), la qualité des données (les informationsrecueillies doivent être conformes à la réalité).
Il est interdit à l’employeur de traiter des données qui ne sont pas indispensables à l’exécution du contrat de travail. Sont notamment protégées les données dites sensibles (les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une « race », des mesures d’aide sociale, des poursuites ou sanctions pénales et administratives) sauf si cela est nécessaire à l’exercice d’une profession (par exemple, la production d’un extrait de casier judiciaire à l’engagement d’une éducatrice).
La travailleuse bénéficie d’un droit d’accès à son dossier personnel. Elle peut demander en tout temps à l’employeur à le consulter et à faire corriger des inexactitudes et obtenir gratuitement des photocopies des documents. En cas de refus de l’employeur de lui laisser consulter son dossier, de rectifier ou détruire des données inexactes, la travailleuse peut s’adresser à la justice pour qu’elle ordonne à l’employeur l’accès au dossier et, le cas échéant, d’effectuer les corrections nécessaires.
L’employeur n’a pas le droit de donner des renseignements concernant la travailleuse à des tiers, notamment des employeurs potentiels, à moins qu’elle ne lui en ait donné l’autorisation de manière expresse.
Voir la réponse
Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire et comment doit-elle être compensée?
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail prévue par le contrat et la CCT: 42 heures par semaine (pour un plein temps), en principe réparties sur 5 jours, ce qui correspond à un horaire annuel moyen de 1900 heures. L’annexe 6 CCT précise les conditions particulières pour les éducateurs, les enseignants spécialisés et le personnel médical et psycho- pédagogique.
Le travailleur est tenu de les exécuter dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les heures effectuées au-delà de la durée normale doivent l’être dans l’intérêt de l’employeur. Cela est évidemment le cas lorsqu’elles sont accomplies à sa demande.
Si c’est le travailleur qui prend l’initiative, ces heures seront considérées comme « heures supplémentaires » si elles correspondent objectivement à l’intérêt de l’employeur, si elles sont justifiées (impossible de faire autrement en raison d’une urgence, par exemple), et si l’employeur en a connaissance.
Il est donc vivement conseiller d’en informer au plus vite l’employeur. Ceci afin de prévenir toute éventuelle contestation ultérieure. La preuve du bien fondé ou de la réalité d’heures de travail supplémentaires est beaucoup plus difficile à apporter des mois ou des années après les faits.
Pour la définition de l’heure supplémentaire, il faut se référer au numéro précédent (FOPIS Info de septembre 2008).
Le collaborateur ne peut être tenu d’accomplir plus de 120 heures supplé- mentaires par année civile.
La CCT prévoit que les heures supplémentaires doivent être compensées à raison d’une heure pour une heure supplémentaire de travail. Cette compensation doit intervenir dans les six mois. Si la compensation sous forme de congés n’a pas pu se faire, les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux horaire du traitement mensuel majoré d’un quart.
Les heures supplémentaires accomplies la nuit ou un jour chômé donnent droit à une rétribution supplémentaire même si elles ont été compensées par des congés. L’indemnité pour l’heure supplémentaire accomplie la nuit ou un jour chômé est de Fr. 7.30.
Voir la réponse
Peut-on exercer une activité associative ou syndicale pendant le temps de travail?
La liberté syndicale (art. 28 constitution fédérale) ne réside pas seulement dans la possibilité de choisir d’adhérer ou non à une organisation syndicale. Elle garantit le droit de participer à des activités syndicales de manière que les travailleurs puissent faire « entendre leur voix et exprimer ce à quoi ils aspirent, renforcer leur position au sein de la négociation collective et participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sociale et économique » (site OIT 25.2.03).
Vue leur nature, ces activités peuvent s’exercer parfois pendant le temps de travail, dans la mesure où cela n’empêche pas le collaborateur de respecter l’obligation de consacrer tout son temps de service au travail professionnel (art. 29.1 CCT).
Il s’agit principalement de la distribution ou de l’affichage d’informations syndicales à un endroit réservé ou la prise de connaissance d’informations données par une commission du personnel ou une délégation syndicale. Le collaborateur a aussi le droit de participer pour une durée équivalant à une journée de travail par an à des réunions organisées pendant le temps de travail par des associations professionnelles ou syndicales.
Les collaborateurs qui ont été élus par leurs collègues pour remplir un mandat de représentant du personnel au sein d’une institution (commission du personnel ou délégation syndicale) ont le droit d’exercer leur mandat durant les heures de travail pour autant que cela soit nécessaire et selon les modalités fixées dans le règlement de la commission (voir art. 13 loi sur la participation).
Le collaborateur qui assume des responsabilités au sein d’une association ou d’un syndicat dispose pour l’exercice de cette charge d’un congé payé de 5 jours au plus par année (42 heures).
Voir la réponse
A quand les vacances?
Le but des vacances est le repos. Le collaborateur doit pouvoir au moins une fois par année être libéré de l’obligation de travailler. Ainsi, il pourra se reposer, prendre de la distance par rapport à son travail et se consacrer uniquement à ce qui lui plaît, que ce soit des vacances actives ou le farniente. Pour jouir pleinement de son droit aux vacances, celles-ci doivent être payées. Le salaire afférent aux vacances doit donc être versé pendant les vacances.
La durée minimale des vacances fixée par la loi est de quatre semaines par année. Ce minimum peut bien sûr être augmenté contractuellement. La CCT INFRI-FOPIS prévoit un minimum de 4 semaines et 3 jours (cinq semaines ou 25 jours dès le 1er janvier 2011). L’art. 15 CCT précise que cette durée peut être différente selon les catégories de personnel et l’âge du collaborateur (voir l’annexe 6 CCT).
Les dates des vacances sont fixées par l’employeur compte tenu des besoins de l’institution mais en tenant compte des désirs du collaborateur. Elles doivent être communiquées suffisamment à l’avance par l’employeur (en règle générale au moins 3 mois). Pour que le but des vacances (repos et détente) puisse être atteint, elles doivent être prises de manière consécutive. C’est pourquoi elles comprendront au moins deux semaines de suite, le solde pouvant être fractionné en périodes plus courte. De plus, elles seront prises durant l’année de service. Les reports à l’année suivante sont limités à la moitié au plus des vacances annuelles (maximum 3 semaines). En cas de maladie ou d’accident de plus de 3 jours attesté par certificat médical survenant durant les vacances, celles-ci sont suspendues (pour les enseignants voir l’art. 6.3 annexe 6 CCT)
Tant que dure la relation de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par de l’argent. En cas de résiliation du contrat, les jours de vacances non pris sont payés au terme du contrat. A l’inverse, les vacances prises en trop donnent lieu à une réduction correspondante du salaire.
Fixées en semaines, les vacances converties en jours représentent – pour un droit à 4 semaines et 3 jours – 1,92 jours de vacances par mois lorsque la semaine de travail est répartie sur 5 jours (2.08 jours par mois, pour 5 semaines de vacances par an).
Voir la réponse
C’est la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, dite Loi sur la participation, qui règle la marche à suivre pour l’établissement d’une commission du personnel. Le rôle d’une telle commission est de défendre les intérêts communs du personnel envers l’employeur. Elle doit aussi informer régulièrement les collaborateurs et collaboratrices sur son activité (art. 8).
Première condition à la mise en place d’une commission du personnel, l’entreprise doit compter de manière permanente au moins cinquante travailleurs et travailleuses (art. 1 et 3). La demande de procéder à un vote pour la formation d’une représentation du personnel doit émaner au moins d’un cinquième du personnel (art. 5 al.1). Un vote secret s’ensuit (art. 5 al. 1). Si une majorité des collaborateurs et collaboratrices s’exprime en faveur de la création d’une commission du personnel, des élections doivent ensuite être organisées (art. 5 al. 2).
Le nombre de membres de la commission est déterminé conjointement par l’employeur et le personnel. A cet égard, la loi précise que la taille et la structure de l’entreprise doivent être équitablement prises en compte (art. 7).
La commission constituée, elle a le droit d’être informée en temps opportun et de manière compète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter convenable de ses tâches. En particulier, l’implication de la marche des affaires sur l’emploi du personnel doit faire l’objet d’une information au moins une fois par année par l’employeur (art. 9).
La commission dispose du droit de participation pour quatre domaines particuliers, tous prévus par une loi fédérale : la sécurité au travail, le transfert de l’entreprise, les licenciements collectifs et l’affiliation ou la résiliation à une institution de prévoyance professionnelle (art. 10).
La collaboration avec l’employeur repose sur le principe de la bonne foi. L’employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l’exercice de ses activités. Il met à disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires (art. 11).
Les membres de la commission du personnel bénéficient d’une protection dans le sens où ils ne peuvent être défavorisés en raison du mandat qu’ils occupent ou ont occupé. Les candidats à l’élection à la commission du personnel sont également au bénéfice de cette protection (art. 12). De l’autre côté, les membres doivent observer un devoir de discrétion pendant et après leur mandat (art. 14).
Le mandat peut être exercé pendant les heures de travail à condition que ce mandat l’exige et que les activités professionnelles le permettent (art. 13). Dans ce cas, une décharge est à discuter avec l’employeur.
Voir la réponse
Quand faut-il présenter un certificat médical?
« Dès le 4e jour consécutif d’absence due à la maladie ou à un accident, l’employé fait parvenir un certificat médical à l’employeur. » (art. 21.1 CCT)
Le certificat médical sert à prouver la survenance d’un empêchement de travailler causée par une maladie ou un accident. Il appartient au travailleur de fournir cette preuve. Le certificat médical ne doit pas décrire l’atteinte à la santé (respect du secret médical), mais uniquement attester de l’incapacité de travail. Si l’employeur a de sérieuses raisons de soupçonner le travailleur de lui avoir four- ni un certificat de complaisance, il a le droit de demander, à ses frais, un nouvel examen auprès d’un médecin-conseil. Ce droit appartient également à l’assurance perte de gain en cas de maladie laquelle verse des indemnités journalières dès le 61ème jour d’absence.
Selon la CCT, le certificat médical n’est exigible que dès le 4ème jour d’absence consécutif. En cas de doute de l’employeur sur l’existence d’un empêchement de travailler causé par une maladie ou un accident, c’est à lui d’apporter la preuve de l’inexistence d’une incapacité de travail durant la période considérée.
Autres situations pour lesquelles l’employé doit présenter un certificat médical « Le collaborateur ou la collaboratrice peut être astreint(e) à présenter un certificat médical récent ou à se soumettre, au plus tard à la fin du temps d’essai, à un examen médical effectué par un médecin-conseil désigné par l’employeur et rétribué par lui. » (art.3.5 CCT)
Cet examen doit être en rapport direct avec la nature de l’activité exercée. Le diagnostique ne doit pas être communiqué à l’employeur, mais uniquement les éléments médicaux portant sur l’aptitude à exercer la fonction pour laquelle le
collaborateur est engagé.
« Un congé payé est accordé (…) jusqu’à 5 jours par an sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du collaborateur ou de la collaboratrice, maladie d’un enfant du collaborateur ou de la collaboratrice » (art. 20.2a 8)
Cette disposition conforme à la loi sur le travail (art. 36/3) va au-delà du minimum légal (congé de trois jours au maximum). De plus, le droit au salaire n’est pas réglé par la loi mais par la CCT.
Voir la réponse